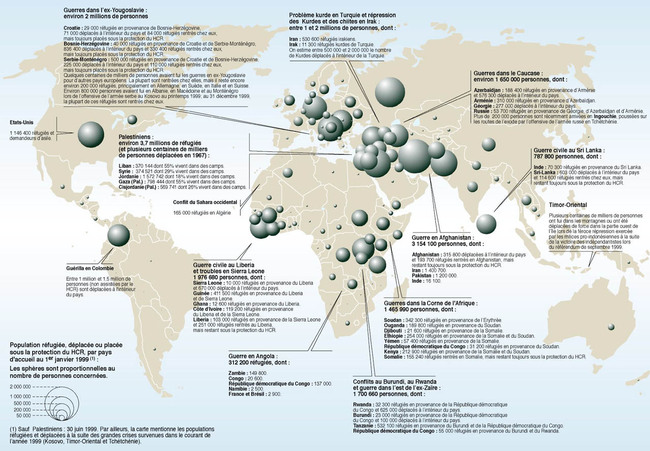-

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a été remis samedi 30 mars 2018 à la Cour pénale internationale (CPI) par les autorités maliennes.
Agé de 40 ans et de nationalité malienne, M. Al Hassan est arrivé au quartier pénitentiaire de la CPI à La Haye, aux Pays-Bas.
Selon un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire I de la CPI le 27 mars dernier, M. Al Hassan est suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis entre avril 2012 et janvier 2013 à Tombouctou, au Mali.
« La Chambre est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un conflit armé à caractère non-international a débuté en janvier 2012, et était toujours en cours au Mali pendant toute la période des faits allégués », souligne un communiqué de presse de la CPI publié samedi. Pendant cette période, courant du début avril 2012 jusqu'au 17 janvier 2013, la ville de Tombouctou aurait été sous la domination des groupes armés Al Qaïda au Maghreb Islamique (« AQMI ») et Ansar Eddine, mouvement principalement touarègue associé à AQMI.
« M. Al Hassan aurait joué un rôle de premier plan dans la commission des crimes et la persécution religieuse et sexiste infligée par ces groupes armés à la population civile de Tombouctou », précise le communiqué de la Cour. Selon le mandat d'arrêt, M. Al Hassan qui appartient à la tribu touarègue/tamasheq des Kel Ansar, aurait été membre d'Ansar Eddine et aurait été commissaire de facto de la Police islamique. Il aurait également été associé au travail du Tribunal islamique à Tombouctou et aurait participé à l'exécution de ses décisions.
M. Al Hassan aurait pris part à la destruction des mausolées des saints musulmans à Tombouctou grâce à l'utilisation des hommes de la Police islamique sur le terrain. Il aurait aussi participé à la politique de mariages forcés dont des tombouctiennes ont été victimes, qui ont donné lieu à des viols répétés et à la réduction de femmes et de jeunes filles à l'état d'esclaves sexuelles.
La Chambre a conclu que les preuves présentées par le Procureur de la CPI donnent des motifs raisonnables de croire que M. Al Hassan serait pénalement responsable au sens des articles 25-3-a ou 25-3-b du Statut, pour des crimes contre l'humanité ainsi que des crimes de guerre.
Le Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, s'est félicitée samedi de la remise de M. Al Hassan à la Cour, la qualifiant « d'avancée significative ».
« L'arrestation d'un suspect, M. Al Hassan, et son transfèrement à la CPI envoient un message fort à tous ceux qui, où qu'ils se trouvent, commettent des crimes qui heurtent la conscience humaine : mon Bureau est fermement résolu à poursuivre sa mission prévue par le Statut de Rome », a dit Mme Bensouda dans une déclaration vidéo.
En tant qu'organe de poursuite, le Bureau du Procureur s'est dit résolu à continuer son mandat et a souligné qu'il apprécie et respecte le processus judiciaire indépendant de la Cour qui octroie au suspect le droit à une procédure régulière garanti par le Statut de Rome, y compris la présomption d'innocence. « Dans l'accomplissement de ce travail, nous continuons de penser avant tout aux victimes et de faire tout notre possible pour que la justice qu'elles méritent tant leur soit rendue », a précisé Mme Bensouda.
La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali (MINUSMA) a pris acte du transfèrement à la CPI de M. Al Hassan. Pour la mission de maintien de la paix onusienne, ce tranfèrement représente un « développement important » dans les efforts de lutte contre l’impunité pour une paix durable au Mali.
« Je crois fermement que ce transfèrement est une avancée importante pour la quête de justice, de lutte contre l'impunité et de reddition des comptes pour les auteurs d'abus et violations graves des droits de l’homme au Mali », a déclaré Mahamat Saleh Annadif, le Représentant spécial du Secrétaire général au Mali dans un message publié sur les réseaux sociaux de la MINUSMA.
La situation au Mali a été déférée à la CPI par le gouvernement malien le 13 juillet 2012. Le 16 janvier 2013, le Procureur de la CPI a ouvert une enquête sur les crimes présumés commis sur le territoire du Mali depuis janvier 2012.
Le Procureur de la CPI et le Greffier de la Cour, Herman von Hebel, ont remercié les autorités maliennes pour leur coopération dans le cadre de cette affaire. « La coopération est au centre de l'efficacité du système institué par le Statut de Rome », a tenu à rappeler Mme Bensouda.
L'affaire à l'encontre de M. Al Hassan est la deuxième affaire dans le cadre de cette situation après l'affaire à l'encontre de M. Al Mahdi déclaré coupable et condamné à neuf d'emprisonnement pour le crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou, au Mali, en juin et juillet 2012.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le Statut de Rome, texte fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), a vingt ans cette année. La Cour a depuis ouvert des enquêtes dans onze affaires et pourrait s’investir dans une douzième très bientôt. Tour d’horizon.
Le Statut de Rome, adopté en 1998, est entré en vigueur après sa ratification par 60 États en 2002 - date à laquelle la Cour pénale internationale fut officiellement créée. Elle est compétente « à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale », à savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Le crime d’agression sera de sa compétence à compter de juillet 2018.
Par où fallait-il commencer ? La réponse à cette question fut donnée à Luis Moreno Ocampo, le premier procureur de la Cour pénale internationale, par deux États africains en janvier et avril 2004. En effet, l’Ouganda et la République démocratique du Congo (RDC) ont alors tous deux demandé à la CPI d’intervenir. En janvier, le gouvernement ougandais demandait de l’aide concernant le conflit entre l’Armée de résistance du seigneur (Lord Resistance Army, LRA) et les autorités régulières. La LRA était tristement connue pour l’enlèvement de milliers d’enfants, s’en servant comme esclaves sexuels ou comme soldats.
Une enquête fut ouverte en juillet de la même année et cherchait à trouver les plus hauts responsables de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre dans le nord du pays. Un an plus tard, la Cour délivra sous scellés un mandat d’arrêt concernant Joseph Kony (considéré comme le chef de la LRA), Dominic Ongwen, et les désormais défunts Raska Lukwiya et Okot Odhiambo – le mandat n’a pas été levé concernant Vincent Otti, dont le décès est envisagé.
Malgré un effort international pour capturer Joseph Kony, celui-ci court toujours. Dominic Ongwen, quant à lui, s’est rendu aux forces américaines présentent en Centrafrique en janvier 2015. Son procès a commencé en décembre 2016. Comme l’expliquait alors Human Rights Watch, « les poursuites judiciaires contre Ongwen soulèvent des questions importantes concernant son statut d’ancien enfant-soldat, même si les crimes dont il est accusé ont été perpétrés alors qu’il était adulte. » Le 19 mars, après avoir causé un incident en session fermée d’une audience, l’accusé a été sorti de la salle sur demande des juges.
« Terminator » à la CPI
Depuis des décennies, la RDC connaît un conflit entre forces armées et factions rebelles. Plus de cinq millions de victimes sont à déplorer, dans un jeu de cartes mortel impliquant des pays voisins. En avril 2004, ce fut donc au tour du gouvernement de la RDC de demander l’intervention de la CPI concernant l’investigation de crimes du ressort de la Cour.
Après l’ouverture de la première enquête de la CPI en juin 2004, Thomas Lubanga et Germain Katanga sont devenus les premiers suspects condamnés par l’institution internationale, et Mathieu Ngudjolo Chui fut acquitté. Il n’y a pas eu de procès dans l’affaire Callixte Mbarushimana, puisque les juges n’ont pas confirmé les charges contre lui après l’audience de confirmation des charges, étape précédant un éventuel procès où les parties résument leurs positions. Sylvestre Mudacumura, suspecté de neuf chefs de crimes de guerre, court toujours.
Reste Bosco Ntaganda, le « Terminator » congolais, qui s’est rendu à l’ambassade américaine de Kigali, au Rwanda (son pays d’origine), en mars 2013. Son procès pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité s’est ouvert le 2 septembre 2015.
Un président accusé de génocide
Un an après le démarrage de la machinerie embrayé par l’Ouganda et la RDC, c’est une autre méthode qui va déclencher l’ouverture d’une enquête au Soudan. N’étant pas un État partie au Statut de Rome, la CPI ne peut en principe pas y intervenir et ne peut pas poursuivre ses ressortissants, sauf sur demande du Conseil de sécurité de l’ONU. Ce qui se passa le 31 mars 2005, mentionnant explicitement la situation au Darfour, où, pour rappel, un génocide a causé la mort d’environ 300 000 personnes.
La Cour accusa, au cours des années, sept personnes, dont le président soudanais Omar el-Béchir. Ce dernier fait l’objet, n’ont pas d’un, mais de deux mandats d’arrêt. Le premier ne mentionnait pas le crime de génocide, ce qu’est venu faire le second après l’appel du procureur pour que cela soit fait.
Cette affaire est difficile pour la CPI. Alors qu’elle devrait pouvoir compter sur les États parties au Statut de Rome pour arrêter le président el-Béchir au moins lorsqu’il voyage, nombreux sont ceux qui refusent de coopérer. Une situation maintes fois dénoncée par Fatou Bensouda, la procureure de la Cour depuis 2012. De manière claire et directe, celle-ci interpelle le Conseil de sécurité de l’ONU lors de ses comptes rendus réguliers.
En décembre 2016, elle exposait la situation suivante : « Selon les informations de mon bureau, M. el-Béchir a franchi les frontières internationales à 131 occasions depuis mars 2009 (…). Le monde sait où il se trouve, où il se rend, souvent à l’avance. Il y a de nombreuses occasions d’arrêter M. el Béchir – si la volonté politique existe parmi les États, et parmi ce Conseil. » Un an plus tard, en décembre 2017, elle attaquait directement un membre du Conseil : « Je note qu’il s’est rendu officiellement en Fédération de Russie, membre permanent de ce Conseil. »
En parallèle d’une cour d’un nouveau genre
Au sud-ouest du Soudan se trouve la République centrafricaine, elle aussi lieu de conflits qui n’épargnent pas les civils. Fin 2004, le gouvernement demande l’intervention de la CPI, qui, dans l’enquête qu’elle ouvrira en mai 2007, visera Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de RDC.
Il a été condamné en juin 2016 à dix-huit ans de prison pour des meurtres et des viols commis par un contingent de son Mouvement de libération du Congo sur le territoire centrafricain, puis à un an de prison et 300 000 € d’amende pour « atteintes à l’administration de la justice, sur la base des faux témoignages produits par des témoins de la défense. » Des membres de sa défense et de son entourage ont également été jugés coupables dans cette même affaire. Appels ont été interjetés concernant les verdicts. Le premier est en cours, le second a été rejeté – les juges ont toutefois demandé une nouvelle peine.
Une autre enquête dans une autre situation a été ouverte en Centrafrique, qui se porte cette fois-ci sur les violences de la Séléka et des anti-Balaka depuis le premier août 2012. Si aucun suspect n’a été désigné pour le moment, la CPI apporte son aide à l’établissement de la Cour pénale spéciale, mise en place à Bangui pour poursuivre les responsables des crimes les plus graves. Elle devrait être composée de magistrats locaux et internationaux.
L’échec kényan, où les ennuis commencent
C’est sans aucun doute la plus grande défaite de la juridiction – voire un fiasco, selon à qui vous parlez. En mars 2010 et pour la première fois, elle ouvrait une enquête de sa propre initiative, concernant les crimes contre l’humanité qui auraient été commis lors des violences postélectorales en 2007 et 2008 au Kenya, qui ont causé la mort de 1 200 personnes. Le procureur de l’époque, Luis Moreno Ocampo, désigne six suspects (les « Ocampo six ») des deux côtés politiques, dont le futur président Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto.
Mais les charges ont été retirées avant le procès dans le premier cas, « en raison de preuves insuffisantes », et elles ont été « annulées » dans le second après la présentation des preuves de l’accusation.
« Malheureusement, on se souviendra de cette affaire comme d’une apparente campagne de corruption de témoins », expliquait Elizabeth Evenson de Human Rights Watch concernant l’annulation des charges. Trois mandats d’arrêt sont toujours d’actualité dans la situation kenyane concernant des atteintes à l’administration de la justice qui pourraient expliquer la débâcle.
L’échec kényan ne semble toutefois pas uniquement judiciaire. Selon Mediapart, Luis Moreno Ocampo, alors qu’il ne travaillait plus à la CPI, aurait œuvré en coulisses pour offrir au président kényan une « une sortie honorable ».
 votre commentaire
votre commentaire
-
Si elle entrait en vigueur, la loi punirait de prison ceux qui mettent en cause la Pologne dans les crimes contre les Juifs.
Le Sénat polonais a voté dans la nuit du 31 janvier une loi controversée sur la Shoah, destinée à défendre l'image du pays, mais qui a irrité Israël et fait l'objet d'un sérieux avertissement américain. Pour entrer en vigueur, la loi doit être encore signée par le président polonais Andrzej Duda.
Les Etats-Unis ont exprimé mercredi leur «inquiétude» quant aux conséquences de cette loi. Elle risque d'avoir des «répercussions» sur «les intérêts et relations stratégiques de la Pologne, y compris avec les Etats-Unis et Israël», a mis en garde la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert, estimant que d'éventuelles divisions entre alliés «ne profiteraient qu'à nos rivaux». Elle a appelé la Pologne «à réexaminer la loi à la lumière de ses possibles conséquences sur la liberté d'expression et sur notre capacité à être de bons partenaires».
La loi punit par des amendes ou des peines de prison allant jusqu'à trois ans de réclusion ceux qui attribuent «à la nation ou à l'Etat polonais» des crimes commis par les nazis allemands en Pologne occupée. Aux yeux des conservateurs au pouvoir en Pologne, il s'agit en priorité d'empêcher qu'on utilise l'expression «camps de la mort polonais» à propos de ceux installés par les nazis allemands en Pologne occupée.
Mais les responsables israéliens s'émeuvent surtout d'un passage où ils voient une tentative de nier la participation de certains Polonais à l'extermination des juifs, voire la possibilité de poursuivre des survivants de la Shoah qui évoqueraient de tels cas. Après l'adoption du projet de loi par la chambre basse vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a protesté vivement: «Nous ne tolérerons pas qu'on déforme la vérité et réécrive l'Histoire ou qu'on nie l'Holocauste», a-t-il dit.
Des protestations d'organisations juives à l'étranger ont suivi. Mais le Sénat a adopté le texte sans le modifier.
Pour le vice-ministre polonais de la Justice Patryk Jaki intervenant mercredi devant le Sénat, la violence de la réaction de l'Etat hébreu serait en partie explicable par des questions de politique intérieure israélienne.
Une proposition de loi a été présentée mercredi à la Knesseth et a obtenu l'appui de principe de 61 députés israéliens sur 120. Ce texte, présenté par un de ses promoteurs, le député Itzik Shmuli (Union sioniste), comme une réaction à la loi polonaise, introduit une peine de cinq ans de prison pour ceux qui «réduisent ou nient le rôle de ceux qui ont aidé les nazis dans les crimes commis contre les Juifs».
A Varsovie, une centaine d'artistes, journalistes et hommes politiques polonais, dont la réalisatrice Agnieszka Holland, l'ancien président de gauche Aleksander Kwasniewski et l'ancien chef de la diplomatie, le libéral Radoslaw Sikorski, ont signé un appel demandant que le projet de loi soit amendé afin d'en éliminer la pénalisation des expressions blessantes pour la Pologne. Ils ont demandé à l'opinion de «maîtriser les émotions, pour le bien commun que sont la vérité et le dialogue polono-israélien depuis un quart de siècle».
6700 Justes
Un groupe de Juifs polonais a également publié une lettre ouverte pour mettre en garde contre la nouvelle loi. Celle-ci «peut conduire à pénaliser ceux qui disent la vérité sur les délateurs polonais et ces citoyens polonais qui assassinaient leurs voisins juifs». Elle «limite non seulement la liberté d'expression, mais avant tout conduit à falsifier l'histoire», ont-ils mis en garde.
Le voïvode (préfet) de Varsovie a de son côté interdit «pour des raisons de sécurité» une manifestation annoncée pour mercredi après-midi par des milieux nationalistes devant l'ambassade d'Israël.
La Pologne occupée par l'Allemagne nazie fut le seul territoire où les Allemands décrétèrent que toute sorte d'aide aux Juifs était passible de la peine de mort. Le site du mémorial Yad Vashem à Jérusalem, dédié à la mémoire de la Shoah, recense 6700 Polonais distingués comme «Justes parmi les Nations» pour avoir aidé les Juifs sous l'occupation nazie.
Le 30 janvier 2018, une médaille y a été décernée à titre posthume à trois Polonais reconnus «Justes parmi les Nations». Un porte-parole de Yad Vashem a assuré à l'AFP que la cérémonie était prévue de longue date et que la coïncidence avec la controverse était fortuite. Six millions de Polonais, dont trois millions de Juifs, ont été tués pendant la Seconde guerre mondiale.
 votre commentaire
votre commentaire
-
L’église catholique renonce peu à peu à la théorie de la guerre juste, invoquée pour justifier certains conflits, et promeut désormais une culture de non-violence.
Qu’est-ce que la guerre juste ?
La guerre juste est une notion antique, exprimée notamment au Ier siècle av. J.-C. par Cicéron, reprise par les Pères de l’Église (notamment saint Augustin) puis formalisée au Moyen Âge par saint Thomas d’Aquin. Selon lui, pour qu’une guerre soit juste, trois conditions devaient être remplies : être déclarée par une autorité légitime, pour une juste cause (réparer une injustice ou se défendre contre une agression), et s’en tenir à une intention droite (rétablir la justice et non assouvir une vengeance).
Au XVIe siècle, le jésuite Francisco Suarez ajoutera qu’une guerre juste doit avoir une chance raisonnable de succès et rappellera qu’elle ne peut être envisagée qu’en dernier recours. De leur côté, les dominicains Raymond de Peñafort (XIIIe siècle) et Francisco de Vitoria (XVIe) ont insisté sur le droit de la guerre, rappelant les principes de proportionnalité (ne pas commettre un tort plus grand que le dommage à réparer) et de discrimination (ne s’en prendre qu’aux combattants).
L’Église a-t-elle changé sa position ?
Malgré l’apparition des États-nations et le concept de raison d’État, l’Église ne va jamais cesser, jusqu’au XXe siècle, de défendre la théorie de la guerre juste. Mais les deux guerres mondiales (notamment la seconde) et le développement des armes de destruction massive (au premier rang desquelles l’arme atomique) vont la pousser à évoluer. « Auschwitz et Hiroshima rendent caduque et indéfendable l’idée d’une guerre pour défendre une cause », résume le père Bruno-Marie Duffé, secrétaire, au Vatican, du dicastère pour le développement humain intégral. Pour lui, « la seule cause est la défense de la vie, qui suppose plutôt une ”anti-guerre” ».
Alors que Léon XIII définissait déjà la guerre comme un « fléau » et que Benoît XV la qualifiait de « massacre inutile », le concile Vatican II va aller plus loin. « Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l’homme lui-même, qui doit être condamné fermement et sans hésitation », insiste Gaudium et spes (n. 80). Dans ce qui constitue sa seule condamnation explicite, le concile appelait à « reconsidérer la guerre dans un esprit entièrement nouveau » et à préparer le jour où « toute guerre pourra être absolument interdite » (n. 82).
« Dans ces conditions, on ne peut plus aujourd’hui parler de “guerre juste” et j’écarterais l’expression, qu’on ne voit d’ailleurs plus depuis un certain temps dans le Magistère, pour celle d’utilisation légitime de la force par les États pour se défendre », résume Christine Jeangey, responsable de la question au dicastère pour le développement humain intégral.
Quelles sont les conditions de la violence légitime ?
Pour Christine Jeangey, l’approche de l’Église en matière d’utilisation légitime de la violence est une mise en œuvre du cinquième commandement : « Tu ne tueras point. »« Pour la protection de la vie des individus et de la communauté humaine, il peut y avoir un recours à la violence », explique le père Duffé, selon qui « sous certaines conditions, un État a même le devoir de protéger son peuple ».
Le Catéchisme de l’Église catholique souligne ainsi « les strictes conditions d’une légitime défense par la force militaire ». « Il faut à la fois, souligne-t-il, que le dommage infligé par l’agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain ; que tous les autres moyens d’y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces ; que soient réunies les conditions sérieuses de succès ; que l’emploi des armes n’entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer » (n. 2309).
« Ces conditions sont les mêmes que celles de la guerre juste, mais cela ne veut pas dire que l’Église reprend la théorie de la guerre juste », estime Christine Jeangey qui insiste sur le droit de la guerre, une fois celle-ci engagée. « Ce n’est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient par le fait même licite entre les parties adverses », résumait Gaudium et spes (n. 79).
L’Église peut-elle aller plus loin ?
Selon Pax Christi, la théorie de la guerre juste continue à être enseignée dans certains secteurs de l’Église. D’autant plus que le Catéchisme emploie encore ce mot, même si c’est pour se borner à relever que ses conditions de la légitime défense « sont les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la ”guerre juste” » (n. 2309). En 2016, le mouvement catholique a donc demandé au pape de supprimer définitivement ce terme. En août dernier, les religieux américains ont, de leur côté, invité le pape François à écrire une encyclique sur la non-violence. « Résolus à répondre concrètement à l’appel de Vatican II pour mettre la guerre “hors la loi” », ils appellent également l’Église à « cesser de justifier la guerre ».
À Rome, ces appels sont écoutés avec une oreille bienveillante. « La guerre juste est abandonnée, au moins implicitement », reconnaît ainsi le père Duffé qui met toutefois en garde contre une vision non-violente qui délégitimerait l’action de ceux qui, sur le terrain, sont aux prises directes avec une violence à laquelle ils doivent faire face comme ils le peuvent.
« Attention à ne pas mettre en difficulté ceux qui s’impliquent dans les institutions et la vie publique : il faut permettre un va-et-vient entre le croire et l’agir », souligne-t-il, posant aussi la question d’une autorité internationale capable d’arrêter les conflits. « Si la guerre juste n’existe plus en tant que telle, la réalité des abus de pouvoir demeure, constate-t-il. Or il faut tout faire pour éviter la violence et sauver des vies ! »
Plutôt que de s’enfermer dans une posture morale déconnectée de la réalité, le Vatican préfère donc s’engager aujourd’hui dans la promotion d’une culture non-violente. En 2017, le pape François avait justement consacré son message pour la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier, à « la non-violence, style d’une politique pour la paix ». Dans ce sillage, le Vatican ne ménage pas ses efforts pour développer dans le monde une culture non-violente, que ce soit en promouvant le désarmement mais aussi le développement pour éliminer les causes des conflits.
N Senez (la croix)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Une étude annuelle du bureau maritime international montre qu’en 2017, 180 actes de piraterie ont été recensés dans le monde, soit 11 de moins qu’en 2016. La zone la moins sûre du globe reste l’Asie du sud-est.
Les mers ont été plus sûres en 2017. C’est le constat qui ressort de l’étude annuelle du Bureau International Maritime (BIM) basé à Londres. Entre janvier et décembre, 180 actes de piraterie réussis ou tentés ont été recensés à travers le globe.
Les actes de piraterie ont donc diminué cette année encore, enregistrant sa 5e année de baisse après des années 2014, 2015 quasi stables. Depuis 2013, la piraterie a baissé d’environs 30 % sur l’ensemble de la planète.

Trois régions du monde restent toutefois des endroits sensibles pour la navigation maritime. Avec en premier lieu, l’Asie du sud-est où pas moins de 76 actes ont été déclarés, soit 42 % des attaques du globe. Le pays le plus risqué pour les navires reste l’Indonésie avec 43 actes de piraterie suivi des Philippines, avec 22 attaques.
Menace toujours présente des pirates somaliens
L’autre point sensible du monde reste l’Afrique avec 57 attaques enregistrées sur le continent. La grande majorité d’entre eux se situent au large du Nigeria, avec 33 actes recensés. À l’est du continent, la Somalie continue de voir les pirates sévir sur leurs côtes. Seuls six événements figurent dans le rapport mais, ils ont été, à chaque fois d’une rare violence.
De plus, d’autres actes dans la région sont imputables aux pirates somaliens car ils agissent souvent au large et alors que les bateaux sont en rythme de croisière. « Les incidents de 2017 montrent que les pirates somaliens gardent la capacité d’attaquer des navires marchand à plusieurs centaines de kilomètre de leurs côtes » s’inquiète Pottengal Mukundan, directeur du BIM.
Le mode opératoire distingue d’ailleurs les actes de piraterie d’Asie et ceux d’Afrique. En Asie, la majorité des attaques se font sur des bateaux à l’ancre. Tandis qu’en Afrique, plus de 60 % de la piraterie s’effectuent sur des navires en navigation.
Un nombre de décès en hausse
Le dernier endroit du monde touché par les actes de piraterie est l’Amérique du Sud avec 24 actes notifiés dans le rapport. C’est le Venezuela qui capte la majorité de ces attaques au nombre de douze, suivi par la Colombie.
Si la piraterie commise dans le monde a globalement diminué en 2017, elle a aussi connu un léger pic meurtrier avec trois décès enregistrés alors qu’il n’y en avait pas eu en 2016 et seulement un en 2015.
En ce qui concerne les pays de rattachement des bateaux touchés par la piraterie, Singapour fait figure d’État le plus touché avec 56 navires attaqués. Pour compléter le podium, 22 navires attaqués étaient dirigés depuis l’Allemagne, ainsi que 22 autres rattachés à la Grèce.
Enfin globalement, ce sont surtout des bateaux de taille importante qui sont pris à partie avec 23 conteneurs et 61 tankers, transportant des produits chimiques, pétroliers ou gaziers.
 votre commentaire
votre commentaire
-

Le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie, à La Haye, a achevé ses travaux jeudi. Mais en Bosnie, la poursuite des criminels de guerre continue, suivie de près par Bakira Hasecic, engagée dans l’aide aux femmes ayant subi des sévices sexuels.
Trois femmes grillent une cigarette dans le froid de cette matinée de décembre. Un couple passe devant elles, s’engouffrant d’un pas ferme dans le petit bâtiment qui abrite le tribunal d’Etat de Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. Chacun regarde devant soi, le visage tendu. L’une de ces femmes, Bakira Hasecic, est la frêle porte-voix de ces milliers de Bosniennes, entre 20 000 et 50 000 selon les sources, victimes de viol pendant la guerre. L’homme à la tignasse blanche qui se présente à l’audience, libre et au bras de son épouse, c’est Luka Dragicevic, le commandant local pendant la guerre, entre 1992 et 1995, des forces serbes de Bosnie stationnées à Visegrad, une petite ville de l’est du pays qui a subi le nettoyage ethnique.
Plus de vingt ans après la fin du conflit, les victimes, à l’instar de ces milliers de femmes violées regroupées au sein de l’association de Bakira Hasecic, n’ont pas renoncé à obtenir réparation. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de La Haye (Pays-Bas), qui a jugé 161 accusés depuis 1993 et en a condamné 55, surtout des hauts responsables politiques et militaires, a fermé ses portes le 21 décembre. Désormais, les survivants et les familles de victimes comptent sur la cour d’Etat de Bosnie-Herzégovine pour que la justice passe. Depuis la création en 2005 d’une chambre dédiée aux crimes de guerre au sein de la juridiction bosnienne, 198 affaires impliquant 323 accusés ont été jugées en première instance. Il s’agit surtout de responsables locaux ou d’exécutants, comme Luka Dragicevic et la dizaine d’accusés comparaissant ce jour-là. Ils seraient environ 5 000 suspects à devoir encore répondre de leurs actes devant la justice. Les accusés sont condamnés dans 80 % des cas. La peine maximale prononcée est de quarante-deux ans de prison. La plus légère, d’un an et six mois.
En droit international comme en droit bosnien, les crimes de guerre, contre l’humanité et les génocides sont imprescriptibles. Les tribunaux des deux entités composant la Bosnie depuis les accords de Dayton de 1995, la République serbe et la Fédération croato-bosniaque, sont également habilités à engager des poursuites pour crimes de guerre. «Les affaires de viols sont systématiquement jugées devant la cour d’Etat», précise Bakira Hasecic.
Jetés dans la Drina
Cheveux blond clair coupés courts, yeux verts inquiets, la sexagénaire observe ce matin l’arrivée des dix accusés, menottés pour certains. Parmi eux, figure Dragan Sekaric, déjà condamné pour meurtres et viols dans une autre affaire, notamment grâce au témoignage de Bakira et à celui de l’une des deux femmes qui l’accompagnent. Ces deux dernières ont été victimes de sévices sexuels au printemps 1992. Elles avaient alors 19 et 13 ans. Les accusés, eux, sont soupçonnés d’être impliqués dans le massacre de Strpci, un petit village des environs de Visegrad, la ville dont elles sont toutes originaires. En février 1993, des paramilitaires serbes ont fait arrêter un train parti de Belgrade en Serbie à destination de Bar au Monténégro pour en faire descendre les voyageurs non serbes. Dix-huit Bosniaques, un Croate et un passager présenté comme arabe, jamais identifiés à ce jour, ont été exécutés. Seuls quatre des corps, jetés dans la Drina, ont été retrouvés.
Les trois femmes s’installent derrière la vitre séparant la salle d’audience de ce petit box réservé au public. A l’autre extrémité du rang ont déjà pris place les proches des accusés, dont l’épouse de Luka Dragicevic, vêtue de noir de pied en cap. Avec leurs rouges à lèvres, leurs brushings voyants et une veste de léopard négligemment jetée sur une chaise, les deux femmes qui accompagnent l’accusé semblent de trop dans ce tribunal. Pour éviter tout incident, un policier est en faction et une caméra filme l’audience. Précaution inutile ce matin : les deux groupes de femmes ne se jettent même pas un regard. Finalement, l’audience est reportée. Car les cinq témoins attendus, pour la plupart citoyens de la Serbie voisine, ne se sont pas présentés. «Ils ont peut-être été menacés, réagit Bakira. Je vais voir si on peut aider le procureur à retrouver des témoins.»
«Des os brisés»
«Ces procès sont importants pour les générations futures», commente Bakira Hasecic, dont l’association «Les femmes victimes de la guerre» compte des membres issus de toutes les communautés du pays. «C’est un message pour ceux qui seraient tentés de recommencer et qui doivent savoir que la justice les rattraperait.» Qu’il s’agisse de réunir des preuves pour permettre l’ouverture d’enquêtes ou de retrouver la trace de témoins ou de criminels présumés, Bakira Hasecic n’en est pas à son coup d’essai. La plaie de la guerre ne s’est jamais vraiment refermée. Au printemps 1992, un de ses voisins, policier, a fait irruption chez elle, accompagné de «tchétniks», des extrémistes serbes, pour lui faire subir, ainsi qu’à ses deux filles et son mari, «des tortures inimaginables». Aujourd’hui, le petit local abritant son association est situé au rez-de-chaussée d’un immeuble gris criblé de balles d’un quartier populaire de Sarajevo. Les murs sont tapissés de photos : une maison calcinée et un homme moustachu.
Ce dernier, Radomir Susnjar, inculpé pour crimes de guerre par le parquet bosnien, s’est caché pendant des années dans la banlieue parisienne. Prochainement, il devrait être extradé à Sarajevo. «On n’a que deux ans d’écart, je le connais depuis toujours», commente Bakira Hasecic. L’ancien livreur est soupçonné d’avoir participé, le 14 juin 1992, au massacre de 59 civils bosniaques, dont «un enfant de deux jours qui n’avait pas eu le temps de recevoir un prénom», précise Bakira Hasecic. Ce jour-là, 66 personnes avaient été enfermées dans une maison pour y être brûlées vives.
Bakira Hasecic a soigné l’une des sept personnes à avoir survécu: «Cette femme qui avait réussi à sauter par une fenêtre s’était cachée pendant trois jours dans un ruisseau. Elle est arrivée à travers les champs dans un village à côté de Visegrad, où nous étions cachés. D’elle émanait une odeur tellement forte qu’on ne pouvait pas l’approcher à cinq mètres, même après l’avoir lavée et désinfectée avec de l’alcool. Des vers s’échappaient de l’une de ses mains. Elle avait des os brisés.» Ensuite, en repérant le compte Facebook de la femme de l’accusé, la militante bosnienne a retrouvé la trace de Susnjar, disparu depuis des années.
Frais de justice
En Bosnie, où les criminels de guerre sont considérés comme des héros au sein de leurs communautés, la cour d’Etat, fondée sous l’impulsion des Nations unies, est honnie par les nationalistes de ce pays encore sous protectorat international. L’acquittement récent d’un commandant de l’armée bosnienne de la région de Srebrenica, Naser Oric, qui était accusé de crimes de guerre, a suscité la colère des leaders bosno-serbes. Comme l’élite politique bosno-croate, ils estiment que ce tribunal juge surtout des Serbes puis des Croates, et peu de Bosniaques. «C’est de la pure rhétorique nationaliste, dans la droite ligne des projets politiques de la Grande Serbie et de la Grande Croatie», tranche Refik Hodjic. L’ancien porte-parole du TPIY et du Tribunal de Bosnie-Herzégovine tient à rappeler le nombre de victimes civiles tuées pendant la guerre en Bosnie : 2 484 Croates, 4 178 Serbes et 31 107 Bosniaques. Par ailleurs, «peu de tribunaux dans le monde se retrouvent sous une telle loupe et sont aussi observés par nombre d’experts internationaux et locaux qui recherchent des failles. Ces juges sont professionnels», insiste Refik Hodzic.
Malgré ce contexte d’hystérie nationaliste permanente, la justice suit son cours. Treize anciens combattants bosniaques de Konjic, en Herzégovine, soupçonnés de crimes de guerre, ont été arrêtés le 4 décembre. Une deuxième opération visant six autres Bosniaques, qui auraient assassiné 30 civils et prisonniers de guerre serbes, a été lancée dans la foulée, le 19 décembre, dans la région d’Ilijas et de Kakanj, au nord de Sarajevo. Ces suspects de crimes de guerre n’ont pas de soucis à se faire pour les frais de justice, qui seront pris en charge par les autorités. Ainsi, le Premier ministre du canton de Sarajevo, Elmedin Konakovic, qui rejette la possibilité que d’anciens combattants de l’armée bosnienne puissent être coupables, vient de décider d’allouer un budget de 300 000 marks convertibles (153 000 euros) pour leur défense.
Une fois leur peine purgée, les criminels de guerre, forts de la considération de leurs concitoyens, occupent parfois des postes à responsabilité, à l’instar de l’ancien chef sécessionniste bosniaque Fikret Abdic, élu l’an dernier maire de Velika Kladusa, une ville située dans l’ouest du pays. Ce septuagénaire, allié des Serbes de Bosnie pendant la guerre, pourra tranquillement finir son mandat. En septembre, la Chambre des représentants, le Sénat bosnien, a rejeté un projet de loi visant à empêcher ceux qui ont été, comme lui, condamnés pour crimes de guerre d’accéder aux responsabilités politiques. «Quand nous avons réussi à revenir à Visegrad après la guerre, sous la protection des forces internationales stationnées en Bosnie, on a reconnu parmi les policiers des gens qui avaient tué et violé, se souvient Bakira Hasecic. Nous avons réussi à en faire licencier quelques-uns.» En Bosnie-Herzégovine, les victimes n’ont pas fini de se retrouver nez à nez avec leurs bourreaux.
 votre commentaire
votre commentaire
-

La Cour suprême du Japon a rejeté la demande de 387 survivants du bombardement de Nagasaki, qui demandaient à obtenir le statut de victimes officielles.
Ils ont survécu à la bombe atomique de Nagasaki en 1945, mais ils ne se trouvaient pas dans le périmètre défini par les autorités pour obtenir le statut de victimes officielles: c'est du moins ce qu'a décidé lundi la Cour suprême du Japon.
La Cour a rejeté la demande de 387 survivants qui se trouvaient à moins de 12 kilomètres de l'épicentre, mais en dehors de la zone reconnue par le gouvernement, selon la chaîne publique NHK et un porte-parole de la juridiction.
Les survivants dans leur cas de figure peuvent uniquement recevoir des soins gratuits pour des troubles mentaux liés à la bombe et leurs complications, selon un responsable de la préfecture de Nagasaki, sur l'île de Kyushu (sud-ouest).
Au total, 6278 personnes sont encore comprises dans cette catégorie, mais elles doivent vivre à Nagasaki pour recevoir ces traitements gratuits, a-t-il précisé à l'AFP.
En revanche, les survivants officiellement reconnus comme victimes de la bombe "peuvent recevoir des soins pour presque tous les types de maladies, peu importe où ils vivent", a-t-il ajouté.
"Je suis déçue", a déclaré à la NHK Chiyoko Iwanaga, une survivante de 81 ans à l'initiative du combat en justice pour l'extension de cette reconnaissance officielle.
"Je ne sais pas comment expliquer (la décision de la Cour suprême, NDLR) à ceux qui ont du mal à payer leurs frais médicaux et à ceux qui sont hospitalisés", a-t-elle ajouté.
Le gouvernement japonais accorde le statut de victime officielle de la bombe atomique aux personnes qui se trouvaient dans un périmètre ovale de 12 kilomètres de long, mais de seulement 7 kilomètres de large.
 votre commentaire
votre commentaire
-

La Procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, devant le Conseil de sécurité. Photo ONU.
L'exécution des mandats d'arrêt pour les crimes graves commis au Darfour demeure un défi considérable pour lequel une coopération renforcée est nécessaire, a estimé mardi, devant le Conseil de sécurité, la Procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda.
Venue présenter le vingt-sixième rapport de son bureau sur la situation au Darfour, que le Conseil a déférée devant cette juridiction internationale en mars 2005, Mme Bensouda a constaté que « l'appareil judiciaire de la Cour » est « enrayé » par l'échec de plusieurs États membres des Nations Unies –parfois des États parties au Statut de Rome de la Cour–, à s'acquitter de leurs obligations internationales d'appréhender et de remettre à la CPI le Président soudanais, Omar Al-Bachir, et quatre autres suspects.
« L'accueil de suspects ne peut devenir la routine habituelle », a-t-elle dénoncé, en rappelant que, de la lutte contre l'impunité au Darfour, dépend le retour de la paix et de la stabilité dans une région toujours émaillée d'incidents violents.
Le Représentant du Soudan, Omer Dabah Fadl Mohamed, a, quant à lui, vu dans « l'obstination de la CPI » « un des rares obstacles » au rétablissement de la paix dans son pays.
S'ils ont reconnu l'amélioration de la situation sécuritaire sur le terrain, notamment en raison de l'arrêt des affrontements entre forces gouvernementales et groupes rebelles, plusieurs membres du Conseil de sécurité ont noté que le Darfour est toujours le théâtre de rivalités intercommunautaires et de violences perpétrées par des milices armées.
Mme Bensouda a longuement évoqué les manquements d'États membres qui, en accueillant le chef d'État soudanais lors de visites officielles, ne se sont pas seulement livrés à une violation flagrante du Statut de Rome, mais ont terni la « réputation même » du Conseil de sécurité et lancé un « affront » à ses résolutions pertinentes.
« Pas plus tard qu'hier », a dit la Procureure, la Chambre préliminaire de la Cour a conclu que la Jordanie avait failli à ses obligations en vertu du Statut en refusant d'exécuter le mandat d'arrêt émis contre le Président Omar Al-Bachir, lorsque celui-ci se trouvait sur son territoire.
« La Chambre a également décidé que cette situation devrait être examinée par l'Assemblée des États parties et le Conseil de sécurité », a relevé Mme Bensouda, en rappelant une décision « sans équivoque » de la même Chambre, qui avait conclu, le 6 juillet dernier, que l'échec de l'Afrique du Sud à appréhender M. Al-Bachir et à le remettre à la Cour était « contraire » au Statut de Rome.
 votre commentaire
votre commentaire
-

Tsahal n'avait jamais autant enrôlé de femmes dans ses unités combattantes que lors des deux dernières périodes de recrutement.
Pendant l'année écoulée, 2700 femmes ont été enrôlées dans des unités combattantes, a indiqué dimanche un officier à des journalistes, se référant aux chiffres publiés après le recrutement de novembre.
Mars et novembre sont les deux principales périodes de recrutement des appelés dans l'armée israélienne. Le service militaire obligatoire est de deux ans et huit mois pour les hommes et de deux ans pour les femmes. La plupart des recrues combattantes servent dans des unités mixtes.
L'officier a souligné que dans les garde-frontières la proportion de femmes est passée de 15% à 35% en trois ou quatre ans. Concernant la conscription des juifs ultra-orthodoxes, il a indiqué que le but fixé par le gouvernement, de 3200 ultra-orthodoxes enrôlés, n'avait pas été atteint puisqu'en 2017 seulement 2850 ont accepté d'accomplir leur service militaire.
Débat sur le service des ultra-orthodoxes
Le service militaire des ultra-orthodoxes fait depuis longtemps débat en Israël et est régulièrement à l'origine de heurts entre des membres de cette communauté (environ 10% de la population israélienne) et la police.
Une décision début septembre de la Cour suprême statuant que les ultra-orthodoxes devaient accomplir leur service militaire comme les autres, et l'arrestation de plusieurs d'entre eux qui ne s'étaient pas présentés aux centres de conscription, ont provoqué des manifestations ces dernières semaines. L'application de la décision de Cour suprême a toutefois été reportée d'un an.
L'officier a ajouté qu'il y avait une «hausse générale continue» du nombre d'ultra-orthodoxes dans l'armée qui s'était établie à 15% entre 2016 et 2017, en raison notamment de la croissance démographique importante de cette population.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Les Etats-Unis de Donald Trump se retirent d'un projet onusien visant à améliorer la gestion des migrants et réfugiés.
Les Etats-Unis ont ajouté samedi 2 décembre 2017 un nouveau secteur, celui des migrants et réfugiés, à une longue liste de projets ou d'accords internationaux dont Donald Trump a décidé de retirer son pays. Cela, au grand dam des partisans du multilatéralisme.
«La mission américaine auprès de l'ONU a informé son secrétaire général que les Etats-Unis mettaient fin à leur participation au Pacte mondial sur la migration», a annoncé dans un communiqué l'administration Trump.
En septembre 2016, les 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU avaient adopté à l'unanimité un texte appelé Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, qui vise à améliorer à l'avenir leur gestion internationale (accueil, aide aux retours, etc.).
Sur la base de cette Déclaration, le Haut commissaire aux Réfugiés a été mandaté pour proposer un Pacte mondial sur les migrants et réfugiés dans son rapport annuel à l'Assemblée générale en 2018. Ce Pacte doit reposer sur deux axes: définition d'un cadre des réponses à apporter à la problématique et programme d'actions.
«Dispositions incompatibles»
«La Déclaration de New York comprend plusieurs dispositions qui sont incompatibles avec les politiques américaines d'immigration et de réfugiés et les principes édictés par l'Administration Trump en matière d'immigration», a expliqué dans un communiqué la mission des Etats-Unis auprès de l'ONU, sans dire lesquelles.
«En conséquence, le président Trump a décidé l'arrêt de la participation des Etats-Unis à la préparation du Pacte qui vise à obtenir un consensus à l'ONU en 2018», a-t-elle ajouté.
Depuis son entrée en fonctions en janvier, le républicain Donald Trump a entrepris de prendre le contre-pied de nombre d'engagements pris par son prédécesseur démocrate Barack Obama. Plusieurs mesures ont déjà visé le secteur de l'immigration aux Etats-Unis.
«Souveraineté américaine»
«L'Amérique est fière de son héritage en matière d'immigration et de sa conduite dans le soutien aux populations migrantes et réfugiées à travers le monde», a affirmé dans le communiqué l'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley. Mais «l'approche mondiale de la Déclaration de New York est juste incompatible avec la souveraineté américaine», a-t-elle expliqué.
«Nos décisions sur les politiques d'immigration doivent toujours être prises par les Américains et les seuls Américains», a insisté Nikki Haley, qui a le rang de ministre aux Etats-Unis et est une fidèle de Donald Trump.
Réponse mondiale nécessaire
«Les migrations sont un problème mondial qui réclame une réponse mondiale», a rétorqué dans un communiqué le président en exercice de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de la diplomatie slovaque, Miroslav Lajcak, en déplorant la décision étasunienne.
La première année de présidence de Donald Trump a été marquée par plusieurs retraits spectaculaires d'accords internationaux ou de projets d'accords impliquant plusieurs pays du monde.
Précédents
Au risque de l'isolement, les Etats-Unis, première puissance mondiale, sont ainsi devenus le seul pays à ne plus vouloir faire partie de l'Accord de Paris (2015) visant à limiter le réchauffement climatique de la planète. Washington a aussi décidé récemment de se retirer de l'Unesco, l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture, que Donald Trump juge peu favorable à Israël.
Dans un autre domaine, la lutte contre la prolifération nucléaire, le président étasunien ne reconnaît plus que l'Iran respecte un accord international de 2015 visant à garantir le caractère pacifique de son programme atomique. Cette position est un premier pas vers une possible fin pour cet accord.
Le retrait américain du projet de Pacte mondial sur les migrations intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a multiplié en novembre les réunions sur la question migratoire. Après la crise des migrants et réfugiés cherchant à gagner l'Europe, le sujet a repris de l'acuité avec l'exode massive depuis août de Rohingyas de Birmanie vers le Bangladesh et des informations sur l'existence de marchés d'esclaves en Libye.
 votre commentaire
votre commentaire
Le blog d'information sur le droit international